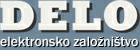| Pajol
Slovénie : histoire et lutte des «
effacés » de la citoyenneté
Mise en ligne : samedi 25 novembre 2006
En 1992, la République de Slovénie a procédé à « l’effacement
» légal, c’est-à-dire à la mort civile de milliers d’individus. Il
s’agit de personnes originaires d’autres républiques ex-yougoslaves,
résidant de longue date en Slovénie, mais qui n’ont pas obtenu la
citoyenneté slovène après l’indépendance. On compte aussi parmi eux
de nombreux Rroms. Ce long déni de justice a été condamné par la Cour
constitutionnelle de Slovénie, mais sans que cela n’améliore la
situation des personnes concernées.
Par Les Effacés
Le 26 Février 1992, le ministère de l’Intérieur a effacé des
milliers de personnes des Registres des Permanents Résidents en
République de Slovénie (des sources officielles de ce ministère ont
avancé le nombre de 18 305 personnes, bien que d’autres sources
affirment qu’il est bien supérieur).
Avant l’instauration du nouvel État, tous les résidents de la
république slovène étaient égaux devant la loi - notre citoyenneté
yougoslave nous conférait à tous les droits civils et politiques. L’effacement
des registres, qui a joué un rôle dans la formation du nouvel Etat et du
corps citoyen en 1991/92, peut être interprété comme une violation
sévère des droits sociaux, économiques, politiques et humains, fondée
sur des motifs ethniques. Cet effacement touche tout autant la
citoyenneté que le permis de résidence.
Dans le processus de formation du nouveau corps citoyen, les résidents
de Slovénie originaires des autres républiques de l’ex-Yougoslavie ont
été appelés à remplir un formulaire afin d’obtenir la citoyenneté
slovène. Bien que nous ayons été résidents permanents depuis de
nombreuses années en Slovénie, voire même notre vie durant, il nous
fallait donc réclamer la citoyenneté slovène d’une manière
différente que les Slovènes d’origine. Environ 1 % de la population
slovène n’a pas réussi à obtenir cette citoyenneté en 1991/92, soit
parce qu’aucun formulaire n’a été rempli, soit parce que la demande
a été rejetée. Nos droits furent violés puisque nous fumes privés,
sans aucune raison objective ou légitime, du statut dont nous avions pu
jouir jusqu’alors ; nous fumeseffacés du Registre des Résidents
Permanents par le Ministère des Affaires Intérieures le 26 février
1992.
L’application de la Loi relative aux Etrangers a alors annulé tous
les droits que nous possédions. Du point de vue de la loi, nous étions
mis sur le même plan que les étrangers illégaux. Nous, les Effacés,
avons subitement été dépouillés de notre droit de résidence en
Slovénie (dans nos maisons, avec nos familles), du droit de franchir les
frontières étatiques, et de tous les autres droits économiques, sociaux
et politiques. Certains d’entre nous ont été détenus, et déportés.
Cet effacement a considérablement affecté nos vies en tant qu’individus,
et membres de nos familles.
Cet effacement des Registres des résidents permanents a été mené
dans le secret. Nous n’avons pas été informés du changement de notre
statut de résidents, et la plupart du temps, c’est seulement par hasard
que nous l’avons découvert. Par exemple, lors de visites de routine aux
administrations locales, il nous était demandé de présenter nos
papiers, qui étaient confisqués, et promptement détruits. Certains d’entre
nous sont devenus de facto des apatrides, car nous ne disposions pas (et
ne disposons toujours pas) de passeport étatique.
Qui sommes nous, nous les Effacés ? Pour la plupart, nous venons des
autres républiques d’ex-Yougoslavie, et nous sommes déplacés en
Slovénie dans les années 1960, 70 ou 80 pour des raisons diverses - la
plus commune étant le travail. C’était l’époque où la Slovénie
avait besoin de nous, pour le développement rapide de son industrie
lourde et de son économie. Les Effacés représentent une parcelle d’un
groupe plus large de migrants internes. Suite à l’indépendance, de
nombreux migrants ont obtenu la citoyenneté (171 000). Mais ceux d’entre
nous qui ne l’ont pas obtenue ont été « punis » par une «
exécution civile » : Privation de nos permis de résidence, et de ce
fait suppression de nos droits. Parmi nous, il y a aussi des enfants nés
en Slovénie, qui y ont grandit et y ont suivi leur scolarité. De plus,
certains d’entre nous ont des parents slovènes, mais sont nés dans d’autres
républiques d’ex-Yougoslavie.
Les Rroms, l’une des minorités les plus oppressées de Slovénie,
font aussi partie des Effacés. Les estimations montrent que 2 000 Rroms
ont été effacés, bien que le nombre réel soit inconnu.
Quelles sont les conséquences de l’effacement ? Certains d’entre
nous ont été forcés à émigrer - nous sommes alors partis vers l’Italie,
l’Allemagne, la Belgique, et les nouveaux Etats de la région
anciennement yougoslave. D’autres ont eu à prétendre qu’ils étaient
des demandeurs d’asile ou des réfugiés en République de Slovénie -
pays dans lequel nous vivions, peu de temps avant, comme de légitimes
citoyens.
Nombreux furent ceux qui restèrent en Slovénie, condamnés à une
existence illégale. Parfois, nous étions détenus dans des postes de
police, ou dans des centres de détention. Nous savons qu’il existe des
cas de suicides et de morts, dus à des soins insuffisants et à la
pauvreté.
Nombreux perdirent leur emploi, sans pouvoir en retrouver un autre.
Beaucoup perdirent leur droit à pension. Contrairement aux autres
résidents slovènes, nous n’avions pas le droit d’acheter les
appartements dans lesquels nous vivions. Nous n’obtinrent pas de
certificats de propriété comme les autres citoyens slovènes, alors
même que notre contribution au développement du « common wealth »
slovène équivalait à la leur. De plus, nous ne pouvions conduire nos
voitures, puisque nos permis de conduire - émis en République de
Slovénie - avaient été confisqués et détruits par l’administration.
Nous n’osions pas quitter le pays, car nous n’aurions pas été
autorisés à y entrer à nouveau. Certains d’entre nous ont été
expulsés de leurs maisons.
L’effacement a séparé de nombreuses familles, car certains d’entre
nous ont été déportés de force hors du territoire slovène. Nous nous
cachions de la police, furent victimes de raids policiers, de menaces, de
pressions psychologiques quotidiennes, et parfois même de torture. Du
fait de l’effacement, beaucoup d’enfants ont grandi sans leurs
parents. Certains parents ont été dépouillés de leur droit à la
parentalité.
La Cour Constitutionnelle de la République de Slovénie et d’importants
comités internationaux ont condamné l’effacement, et ont demandé qu’il
soit remédié aux injustices.
Pendant plus de dix ans, les expériences et la souffrance des Effacés
ont été enveloppées de silence. C’est seulement en 2003 que l’effacement
est devenu une problématique publique importante. D’abord en 1999, puis
de nouveau en 2003, la Cour Constitutionnelle a demandé qu’il soit
remédié à ces injustices, par le biais d’une réinscription au
Registre de tous les effacés du 26 février 1992. Cependant, au lieu d’être
immédiatement et inconditionnellement réenregistrés, nous - et notre
effacement - sommes devenus un sujet de débat électoraliste. Les parties
de droite du Parlement ont dépeint les « citoyens slovènes » comme des
victimes qui, en tant que débiteurs d’impôts, auraient à payer une
indemnité aux Effacés. Dans le même temps, nous fumes présentés comme
des imposteurs qui cherchaient à exploiter à la fois l’Etat slovène,
et ses citoyens.
Condamnations internationales
À la suite de la décision de la Cour Constitutionnelle, plusieurs
comités de l’ONU (le Comité des droits de l’homme, le Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale, le Comité des droits de l’enfant, le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels) ont demandé que l’Etat
slovène règle notre situation. Les comités firent part de leur
appréhension quant aux effets de l’effacement sur le respect des droits
de l’homme, et appelèrent à l’exécution immédiate de la décision
de la Cour constitutionnelle slovène.
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels fit en 2006 la
déclaration suivante. « Le Comité observe que cette situation comporte
des violations des droits économiques et sociaux de ces personnes, à
savoir le droit au travail, à la sécurité sociale, aux soins médicaux
et à l’éducation. (...) Le Comité recommande avec insistance à l’Etat
de prendre les mesures législatives et autres, nécessaires pour
remédier à la situation des nationaux des états de l’ex-Yougoslavie
qui ont été « effacés », lorsque leurs noms furent supprimés des
Registres de la population en 1992. » (Conclusions finales du Comité,
adoptées le 25 janvier 2006, E/C.112/SNV/CO/1)
Une appréhension identique a été exprimée par le Comité
consultatif du Conseil de l’Europe : « Le Comité consultatif note avec
inquiétude que, malgré les pertinentes décisions rendues par la Cour
Constitutionnelle, plusieurs milliers de personnes dont les noms ont été
rayés des Registres des Permanents Résidents le 26 février 1992, et
transférés automatiquement sur les Registres des étrangers, sont
toujours en train d’attendre la clarification de leur statut légal,
plus de dix ans plus tard. (...) Dans de nombreux cas, le défaut de
citoyenneté ou l’absence de permis de résidence a eu un impact
particulièrement négatif sur la situation de ces personnes. En
particulier, cela a donné lieu à la violation de leurs droits
économiques et sociaux, puisque certains d’entre eux ont perdu leurs
maisons, leur emploi ou leur droit à une pension de retraite, et a
sérieusement entravé leur droit à mener une vie familiale et leur
liberté de mouvement. » (Conseil de l’Europe, 1er décembre 2005)
Le Haut-commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe,
Alvaro Gil-Robles, a lui aussi saisi plusieurs occasions pour pointer du
doigt le problème des Effacés (en 2003 et 2006). Entre autres choses, il
a écrit :
« Le problème des personnes effacées continue d’être une question
politiquement lourde en Slovénie, qui divise l’opinion, et elle fait l’objet
de débats passionnés. Malheureusement, la question a souvent été
instrumentalisée par certains partis politiques, qui en ont fait un outil
de campagne. Tout spécialement pendant la période qui a mené aux
élections générales d’Octobre 2004, de nombreux politiciens ont émis
des déclarations xénophobes en se référant aux problèmes des
Effacés, et à d’autres personnes considérées comme non-Slovènes ou,
d’une manière ou d’une autre, différentes. (...) Concernant la
promulgation de la loi régissant et réinstaurant le statut des personnes
toujours effacées à ce jour, le Commissaire recommande avec insistance
au gouvernement slovène de résoudre définitivement la question en toute
bonne foi, et conformément aux décisions de la Cour Constitutionnelle.
Quelque soit la solution législative choisie, l’impasse actuelle
témoigne d’un respect médiocre de la règle de droit et des décisions
de la Cour Constitutionnelle en Slovénie. » (Rapport en date du 29 Mars
2006)
Ces rapports ont aidé à l’internationalisation du problème.
Néanmoins, la question de l’effacement reste irrésolue aujourd’hui.
Un grand nombre des Effacés n’a toujours pas réussi à obtenir des
documents, ni les droits attachés à la citoyenneté. Nous devons
toujours nous cacher de la police, et l’Europe sans frontières ne
représente pour nous rien d’autre qu’une vide promesse.
La lutte des Effacés
Nous, les Effacés, ne nous considérons pas comme des victimes ; bien
au contraire, nous sommes en train de devenir un sujet politique
incontournable !
Pendant longtemps, nous, les Effacés, n’avons pas su que la violence
et l’exclusion dont nous faisions l’expérience n’était pas le lot
de quelque rares individus, mais de milliers de personnes (autrement dit
1% de la population de la République de Slovénie). La vérité a mis des
années à voir le jour, et nous-mêmes avons mis du temps à appréhender
l’acte d’effacement dans toutes ses dimensions tragiques. Peu à peu,
nous avons commencé à nous rencontrer, à comparer nos expériences et
à nous adresser au public. Nous avons débuté alors notre lutte
politique et juridique pour la ré-attribution du droit dont nous avons
été dépouillé, de manière inconstitutionnelle, en 1992.
Nous avons organisé des protestations publiques en Slovénie, et avons
suivi de nombreuses manifestations se battant pour la reconnaissance des
droits de l’homme pour les immigrés, en Italie. De plus, nous avons
organisé des séminaires, des tables rondes, des expositions et des
tribunes publiques concernant le problème des individus effacés, en
Slovénie et à l’étranger (en Italie, Grande-Bretagne, France,
Danemark, Autriche, et ailleurs). Nous avons aussi tenu des discussions
avec les ambassadeurs des autres républiques ex-yougoslaves, et avons
rencontré des membres du Parlement européen. Nous avons conduit
plusieurs actions puissantes, comme des grèves de la faim, une marche de
Koper à Ljubljana, ainsi que des événements d’expression artistique
activiste.
À l’été 2006, nous avons symboliquement ouvert la première «
Ambassade des Effacés » en Italie, à Venise. En Juillet 2006, Anton
Giuglio Lana, une organisation d’avocats italienne spécialiste des
droits de l’homme, a déposé une plainte groupée devant la Cour
Européenne des Droits de l’Homme. Cette plainte est fondée sur le cas
de 11 personnes qui n’ont toujours pas de statut légal en Slovénie, et
qui se trouvent donc peu à même de s’en sortir.
Notre initiative de construction de réseau et d’engagement politique
s’est appuyée sur l’instauration de deux organisations non
gouvernementales, qui disposent de relations avec des individus locaux,
ainsi qu’à l’étranger. Nous avons développé des alliances et une
coopération avec plusieurs associations de défense des droits de l’homme,
avec des activistes et des chercheurs critiques. Une campagne médiatique
est en cours, en Slovénie (MagazineMladina ; Quotidiens Ve ?er, Dnevnik,
Delo ; Radio Student et Radio Marš) et à l’étranger (Quotidien
italien Il Manifesto). Des articles scientifiques et des ouvrages ont
été publiés, et des films ont été présentés (en Grande-Bretagne,
Slovénie, Italie, et Hollande).
Cependant, le public slovène continue d’être rigoureusement
divisé, entre les sympathisants de notre lutte d’un côté, et ses
adversaires de l’autre. Ces derniers nous perçoivent comme des ennemis
de la nation et de l’Etat slovène, et comme des opportunistes
politiques. Certains d’entre eux - parmi lesquels se trouvent même des
membres du Parlement - nous voient comme des suceurs de sang, des lâches,
la lie de l’humanité.
L’effacement n’est pas un problème slovène, mais européen
En 2004, la République de Slovénie est devenue membre de l’Union
Européenne : la liste infinie de conditions à remplir pour accéder à l’Union
ne prévoyait pas la restitution des droits subtilisés aux Effacés. La
Slovénie présidera l’Union Européenne en 2008, et une fois encore, l’effacement
n’a pas été un obstacle pour parvenir à cette fonction hautement
honorable. Ainsi, il est évident que la question des Effacés n’est pas
une entrave à la participation de la Slovénie à un processus que le
public perçoit, pourtant, comme une garantie pour la démocratie.
De notre point de vue, une grande partie du problème réside dans le
fait que les autorités slovènes ne montrent aucune intention de nous
réattribuer nos droits ; de plus, des institutions-clés de l’Union
Européenne n’ont pas eu la volonté de résoudre activement cette
question. Les résidents effacés de la République de Slovénie - qui
sont désormais résidents de l’Union Européenne - se demandent :
Pourquoi l’Europe demeure silencieuse ? Quelles sont ses réelles
normes, valeurs et visons ?
L’effacement est devenu un problème européen. Nous ne sommes pas
les seuls effacés. Il y a différentes sortes d’individus effacés en
Europe, et leur nombre augmente - par exemple, les Rroms nés et vivant en
Italie (qui restent privés de citoyenneté), les descendants des
immigrés algériens en France, les demandeurs d’asile, etc... Il semble
que la culture européenne traditionnelle, celle des droits sociaux, de la
solidarité et du respect des diversités culturelles, a été remplacée
par une politique de détention et de déportation des « immigrés »,
peu important leurs connections avec l’endroit dans lequel ils résident
(il y a 178 Centres de Détention pour migrants et demandeurs d’asile en
Europe).
Nous, les Effacés, nous nous interrogeons : Les droits de la personne
existent-ils en Europe seulement sous la forme d’une déclaration ?
Quelles sont les fondements de la citoyenneté européenne émergente ?
Il existe un besoin urgent de redéfinition du concept de citoyenneté
et de résidence permanente. Nous requérons une compréhension
européenne nouvelle des droits civiques, qui respecte entièrement les
liens véritables et effectifs avec le lieu de résidence, et fasse ainsi
table rase avec le concept périmé de jus sanguinis (la citoyenneté
fondée sur le sang, ou les liens familiaux).
Nous souhaiterions que l’Europe se souvienne de son propre passé d’émigration,
et qu’elle applique cette expérience à la situation actuelle, pour
promouvoir l’inclusion, le soutien et la solidarité avec toutes les
personnes déjà présentes sur le territoire, et avec toutes celles qui
arriveront.
Nous demandons des droits de résidence pour tous les exclus, les
invisibles, et pour tous les effacés d’Europe ! Le permis de résidence
et le droit à la citoyenneté devraient devenir des normes démocratiques
de base !
|
 European Rights Roma Center
European Rights Roma Center